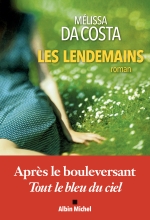Mélissa Da Costa se dévoile 📚

Entrez sous le chapiteau de "Fauves" !
Dans le cirque d’une famille manouche, Mélissa Da Costa dissèque l’engrenage de la violence et de la domination. Une fresque magistrale, au cœur de la cage des félins – et de nos peurs –, où l’écrivaine va au plus près de la vérité du corps, de la peau, du souffle.
Un texte à sentir et à vivre.
Comment présenteriez-vous votre nouveau roman ?
Fauves est un roman qui parle de la violence et des mécanismes de reproduction de la violence. On y accompagne Tony, 17 ans, issu d’une famille dysfonctionnelle, où règne la violence à tous les niveaux (physique, morale, sociale), hanté par l’abandon de sa mère lorsqu’il avait 5 ans et la brutalité atavique de son père. Il pense pouvoir échapper à sa destinée en quittant son père et en intégrant un cirque familial. Mais fuir la violence n’est pas si facile, surtout quand on baigne dedans depuis la plus tendre enfance. C’est ce combat intérieur mené par Tony contre lui-même que nous suivrons, et sa quête éperdue de rédemption.
Le titre suffit à entendre le rugissement des félins. Et la violence de Tony et des hommes ?
La violence des fauves est sauvagerie, elle est physique, fait partie de leur nature et répond à un instinct de survie (se nourrir, se défendre). La violence des hommes est partout dans ce roman. Elle est bien différente de celle des fauves ; elle est construite et s’exprime à de multiples niveaux : verbale, physique, sociale, idéologique. La violence est même valorisée et sublimée par l’art du cirque (le dressage). Cette violence systémique du clan Pulko n’est qu’un reflet de la violence systémique de notre société : l’oppression et l’exploitation du plus faible.
La tension narrative va crescendo. Comment avez-vous construit votre roman ?
Je devais relater la trajectoire d’un héros courant tout droit à la tragédie. Je savais qu’il y aurait des tressautements, des tentatives pour s’en sortir, pour rejoindre la lumière mais que le destin était en cours, inéluctable, écrit pour Tony depuis son plus jeune âge. J’avais ce sentiment que le lecteur devait voir s’éteindre petit à petit les lumières du cirque, qu’il devait sentir l’air se raréfier, le rythme cardiaque s’accélérer, qu’il devait suffoquer avec Tony, et terminer en apnée.
Votre style est serré et dense, votre écriture sensorielle et quasi organique. Comme si votre plume était guidée par l’instinct…
ll y a une grande part d’instinct dans mon écriture. La trame globale est définie dès le début de l’écriture mais elle s’apparente à une simple indication de trajectoire et tient en une vingtaine de lignes. Le reste s’écrit au fil de l’eau, en me laissant totalement guider par mes personnages, l’ambiance des villes traversées, mon envie et ressenti du moment.
Vous vous êtes glissée dans la peau de Tony, de Sabrina, de Chavo…, d’Asia, la panthère nébuleuse. Qu’avez-vous dû abandonner — ou apprivoiser — pour écrire ce roman ?
Il m’a fallu apprivoiser le monde du cirque, sa culture, ses codes, notamment l’endogamie, l’éducation des enfants et la transmission des savoirs. Il m’a également fallu apprendre le métier de dresseur, comprendre les motivations des dompteurs, le lien qui se tisse entre eux et leurs fauves. Pour tout cela, j’ai pu m’aider de lectures et de documentation. En revanche, pour incarner Tony, j’ai dû me lancer sans filet de sécurité… Me mettre dans la peau d’un jeune homme qui voue une haine féroce aux femmes depuis le départ de sa mère. Envisager les femmes avec son regard extrêmement binaire : soit ce sont des mères sacrificielles, tendres, dévouées, soumises, soit des « putes » qui ne méritent aucun respect. Et la moindre déception le pousse à les cataloguer dans la deuxième catégorie.
On découvre le monde des manouches, celui des fauves et du dressage, l’univers circassien… Qu’est-ce qui vous a motivée à voyager dans ces territoires ?
C’est un territoire encore « inexploré », relativement fermé. Qui sait ce qui se passe quand le chapiteau est démonté ? Dans les roulottes ? Comment est régie cette vie en communauté, quelles en sont les règles ? Comment vit-on en permanence en mouvement ? C’est l’inconnu et le mystère qui m’ont poussée à explorer ce monde.
Quelle est la portée symbolique à l’œuvre ? La cage des fauves n’est-elle pas aussi celle de nos peurs, de nos traumatismes ? Le cirque, la métaphore de la transmission, de l’hérédité, le cercle du déterminisme, du « destin » ?
La cage des fauves nous renvoie le reflet de celle des hommes et des femmes. Les hommes du clan Pulko sont emprisonnés dans des logiques de domination, de performance, de démonstration physique tout en restant fortement soumis aux patriarches (Chavo et Pépé Loyal). Ils ne peuvent échapper à leur destinée, ils sont forcés dès leur plus tendre enfance de reprendre le numéro d’un de leurs parents, ne peuvent quitter le cirque sans se voir bannis, reniés. Les femmes du clan Pulko, elles, sont soumises aux hommes, pères, maris, mais aussi et surtout aux croyances, superstitions, au regard social que le clan pose sur elles. Mariage arrangé, culte de la pureté, suspicion de « mauvais œil »… Ne sommes-nous pas tous, nous aussi, enfermés dans une cage invisible, guidés par des déterminismes sociaux, familiaux, par des peurs, des freins que nous nous imposons ? C’est la réflexion qui pourra être amorcée suite à la lecture de ce roman.
Un thème récurrent traverse vos romans : la rupture, le changement de vie pour se réaliser, aller au bout de son rêve. La liberté est-elle le bien le plus précieux ? Celui que Sabrina parvient à arracher à la vie…
Bien sûr, la liberté est le bien le plus précieux. Les fauves le savent très bien. Ils visualisent leur cage, le fouet. Les hommes et femmes qui les entourent ont plus de mal à concevoir la prison dans laquelle ils grandissent. Sabrina a cette lucidité de se savoir prisonnière, qui la rend plus malheureuse mais aussi plus consciente que les autres. Sa quête de liberté sera son leitmotiv, ce qui l’aidera à tenir toutes ces années… Jusqu’à ce qu’elle trouve la force de s’offrir sa liberté.
Tony, lui, reste prisonnier de sa propre violence. Si elle est une force qui lui permet de réaliser son rêve – entrer dans l’arène et dompter des fauves –, elle va aussi précipiter sa chute…
Tony n’a de cesse de vouloir échapper à son enfance, à l’emprise de son père et au modèle de violence qu’il représente pour lui. Mais pour s’émanciper, il reprend justement à son compte les valeurs paternelles : il ne prouvera sa propre valeur qu’en dominant à son tour. En soumettant les fauves. Or la violence n’engendre que la violence en retour. C’est un cercle perpétuel, sans fin, tragique, et c’est le message que je souhaitais transmettre.
Vous citez « l’hymne » des Roms, un peuple venu des Indes, en perpétuel exil : « Djelem, djelem » (« J’ai voyagé, j’ai voyagé »). L’écriture est-elle pour vous un départ ? Un exil ?
L’écriture est un exil, tout à fait. Une fuite du réel pour explorer d’autres univers, défricher des territoires inconnus qui me fascinent. L’écriture me permet de me glisser dans la peau d’autres hommes, d’autres femmes et de mieux comprendre le monde qui m’entoure, les relations humaines, les mécanismes psychologiques. C’est à la fois un voyage vers un ailleurs et une exploration intime immobile.